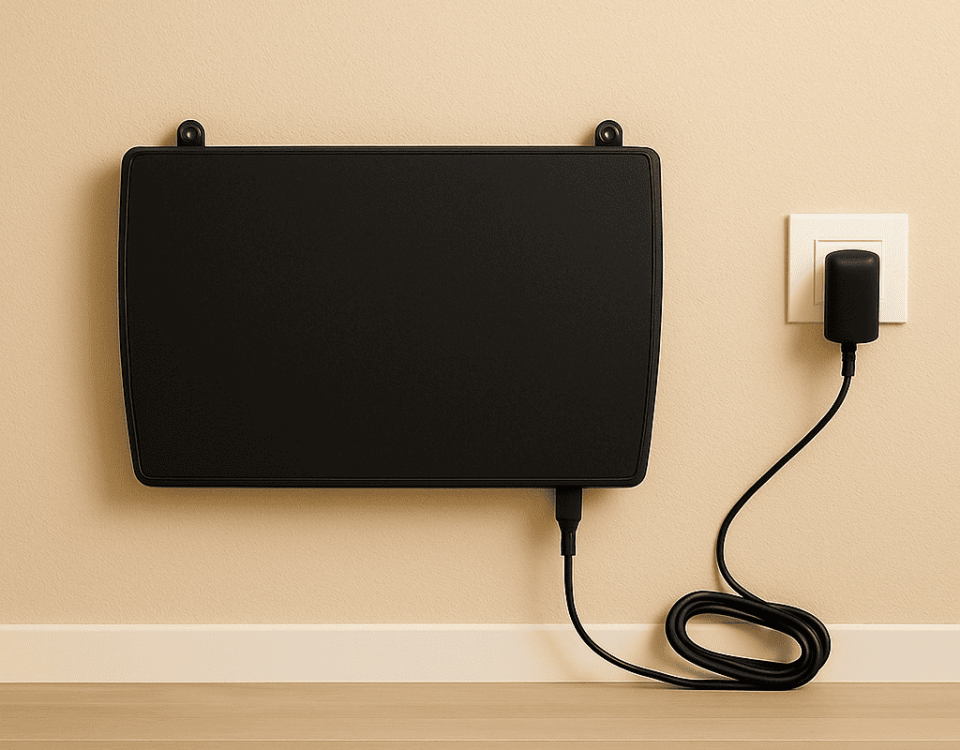Humidistop à l’honneur dans Le Petit Journal
septembre 15, 2025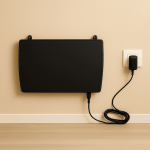
Quelles solutions existent contre les remontées capillaires ?
septembre 23, 2025Introduction
L’humidité dans le bâtiment est un sujet récurrent en pathologie de la construction. Elle peut avoir plusieurs origines : défauts d’étanchéité, infiltrations de pluie, fuites de canalisations, condensation intérieure… Mais il existe un phénomène particulier, à la fois ancien et toujours actuel, qui touche particulièrement les maisons traditionnelles et certains bâtiments récents : les remontées capillaires.
Ces dernières ne sont pas liées à un accident ponctuel, mais à un processus physique continu. Elles résultent de la migration naturelle de l’eau du sol vers les murs, en raison de la porosité des matériaux. Avec le temps, elles provoquent des dégradations visibles et un inconfort certain.
Pour mieux comprendre, il faut examiner en détail le mécanisme, les facteurs qui le favorisent, ses manifestations et ses conséquences, avant même de s’intéresser aux solutions possibles.
1. Définition et mécanisme des remontées capillaires
1.1 Qu’est-ce qu’une remontée capillaire ?
Une remontée capillaire désigne la migration ascendante de l’eau contenue dans le sol à travers les murs en contact avec celui-ci. Elle est due à la porosité des matériaux de construction, qui permettent à l’eau de se déplacer dans leurs capillaires.
Autrement dit, un mur poreux agit comme une éponge : il absorbe l’eau au niveau des fondations, et celle-ci progresse ensuite lentement vers le haut.
1.2 La loi de la capillarité
Le phénomène repose sur la capillarité, loi physique universelle. Lorsqu’un liquide entre en contact avec un matériau poreux, il peut monter à l’intérieur de ses pores, parfois à contre-gravité.
Exemple simple : une mèche de tissu plongée dans un verre d’eau absorbe le liquide, qui monte progressivement le long des fibres. Dans un mur, ce sont les pores de la brique, de la pierre ou du mortier qui jouent ce rôle.
1.3 Hauteur atteinte
En moyenne, les remontées capillaires se manifestent jusqu’à 0,5 m à 1,5 m au-dessus du sol. Dans les cas extrêmes (matériaux très poreux, forte humidité du terrain), elles peuvent atteindre 2 m ou davantage.
2. Facteurs favorisant les remontées capillaires
2.1 Absence de barrière étanche
Dans les constructions modernes, une membrane étanche est généralement placée à la base des murs pour empêcher l’humidité de remonter. Mais dans les bâtiments anciens, cette précaution n’existait pas. Ainsi, la majorité des maisons construites avant 1960-1970 en sont dépourvues, ce qui les rend très vulnérables.
2.2 Nature du sol
La composition du sol joue un rôle clé.
- Les sols argileux retiennent l’eau en grande quantité.
- Les sols limoneux sont peu perméables, ce qui favorise la stagnation.
- Les sols sableux, plus drainants, limitent parfois le phénomène mais ne l’empêchent pas complètement.
2.3 Niveau de la nappe phréatique
Plus la nappe est haute, plus la pression exercée sur les fondations est forte. Dans certains cas, le mur est en contact permanent avec un sol gorgé d’eau, ce qui accentue les remontées.
2.4 Matériaux de construction
Chaque matériau réagit différemment.
- La brique pleine est très poreuse et absorbe rapidement l’eau.
- Les pierres calcaires tendres sont elles aussi sensibles.
- Les mortiers anciens à la chaux laissent facilement circuler l’humidité.
- Le béton moderne est plus étanche, mais ses fissures créent des points d’entrée.
3. Manifestations visibles
3.1 Signes caractéristiques
- Auréoles sombres au bas des murs.
- Cloquage et décollement des peintures ou papiers peints.
- Effritement des enduits et plâtres.
- Dépôts blanchâtres appelés salpêtre.
3.2 Indices indirects
- Odeur persistante d’humidité.
- Plinthes ou huisseries en bois qui gonflent ou pourrissent.
- Carrelages qui se décollent.
- Sensation de parois froides au toucher.
4. Conséquences sur le bâtiment
4.1 Dégradations esthétiques
L’aspect des murs se détériore rapidement. Les travaux de peinture ou de décoration deviennent inutiles si la cause n’est pas traitée.
4.2 Dégradations structurelles
L’eau fragilise les matériaux au fil du temps :
- Les mortiers perdent leur cohésion.
- Les briques se désagrègent en surface.
- Les pierres tendres s’écaillent.
4.3 Le rôle du salpêtre
Les sels dissous dans l’eau migrent avec elle. Lorsqu’ils cristallisent, ils créent du salpêtre. Ce dépôt retient l’humidité et accentue la dégradation, en provoquant des éclatements et fissurations.
5. Conséquences sur le confort intérieur
5.1 Température ressentie
Un mur humide est toujours plus froid qu’un mur sec. Cela augmente la sensation de froid dans la pièce, même si la température est correcte.
5.2 Hygrométrie de l’air
L’air devient plus humide. Cette humidité ambiante rend l’atmosphère plus lourde et moins agréable.
5.3 Consommation énergétique
Un logement humide est plus difficile à chauffer. Les occupants augmentent souvent le chauffage, ce qui engendre une consommation d’énergie plus élevée.
6. Différencier les remontées capillaires des autres problèmes d’humidité
6.1 Condensation
Provoquée par l’humidité de l’air intérieur, elle se manifeste sur les vitres, les coins de murs et les plafonds. Elle est liée au manque de ventilation.
6.2 Infiltrations latérales
L’eau pénètre horizontalement par les façades ou la toiture. Les traces peuvent apparaître à n’importe quelle hauteur.
6.3 Fuites de canalisations
Une fuite crée une humidité localisée et soudaine. Le contrôle des réseaux permet de l’identifier.
7. Comment confirmer un diagnostic ?
7.1 Inspection visuelle
Elle permet de repérer les signes caractéristiques, mais reste insuffisante seule.
7.2 Mesures instrumentales
- Hygromètres à pointe ou à contact.
- Appareils à micro-ondes pour mesurer en profondeur.
7.3 Analyses en laboratoire
- Carottages pour déterminer la teneur exacte en eau.
- Étude des sels pour identifier leur nature.
7.4 Thermographie infrarouge
Elle visualise les zones humides par différences de température.
Conclusion
Les remontées capillaires sont un phénomène naturel, lié à la porosité des matériaux et à l’humidité du sol. Elles apparaissent surtout dans les constructions anciennes, mais peuvent concerner tout bâtiment mal protégé.
Leur progression est lente mais continue, et leurs conséquences touchent à la fois l’esthétique, la durabilité des matériaux et le confort intérieur.
Avant toute décision de traitement, il est indispensable de poser un diagnostic précis, afin de distinguer les remontées capillaires des autres causes d’humidité et d’adapter la solution.